
L'équipe éditoriale MACSF
Le 08.08.2017
À 15:00
3 min

26.03.2024
2 min
Renoncer à une succession pour mieux transmettre
Avec l’allongement de l’espérance de vie, les patrimoines se transmettent de plus en plus tard. Du coup, lorsqu’un héritier estime ne pas av...

26.03.2024
2 min
Prêt familial : comment sécuriser l’opération ?

25.03.2024
La séparation de biens avec société d’acquêts, un régime matrimonial « à la carte »

Le RES Multisupport vous permet d'investir sur une gamme de supports en euros et/ou en unités de compte simple, complète et performante.
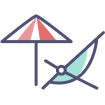
Assurance vie, contrat de capitalisation et plan d'épargne retraite, la MACSF propose des solutions d'épargne retraite adaptées à vos projets.
La revue Challenges lui a décerné le label du meilleur conseil épargne.