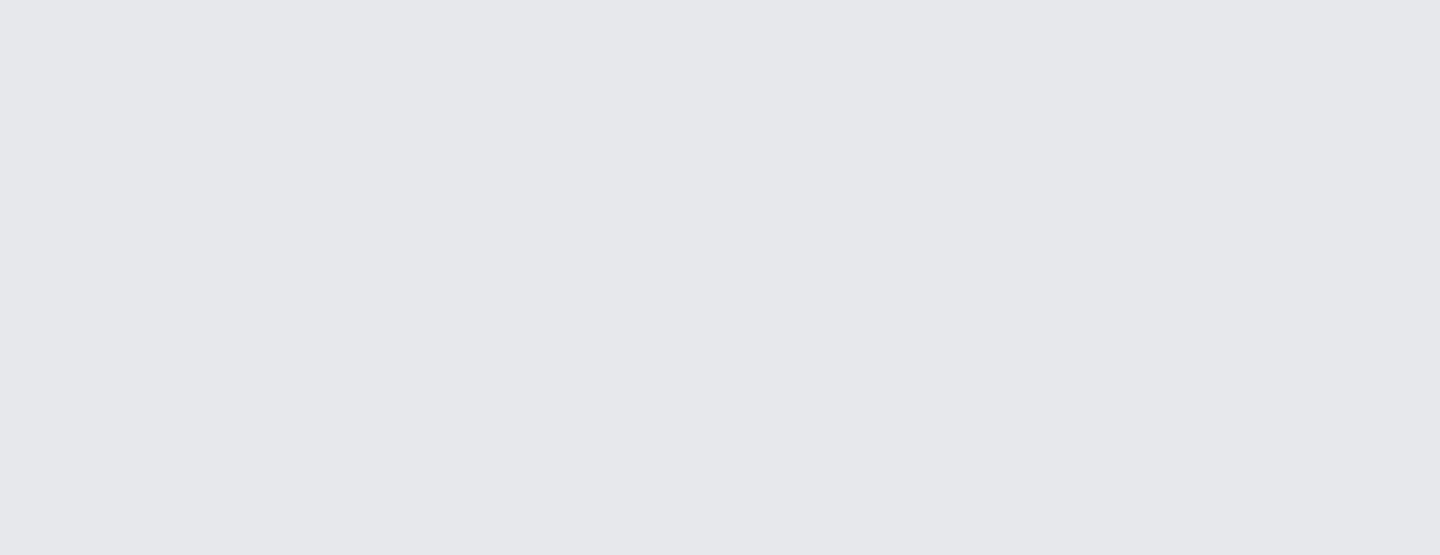IMPORTANT
Le caractère restreint de l’échantillon étudié (149 dossiers) rend les pourcentages peu significatifs et sans réelle valeur statistique. Nous ne les mentionnons ici que pour une meilleure vision des proportions.
Répartition des réclamations
La part des sinistres concernant les animaux de compagnie (52%) reste plus importante que celle concernant les animaux de rente (44%). En 2024 comme en 2023, un seul litige a été déclaré pour des soins réalisés sur un NAC.
Les équidés représentent quant à eux 4% des sinistres enregistrés en 2024.
La part des litiges liés à la reproduction, tous animaux confondus, reste importante puisqu’elle représente près de la moitié des dossiers. Ainsi, en 2024, ont trait à la reproduction :
- 3/4 des litiges déclarés pour les bovins,
- la moitié des litiges déclarés pour les équidés,
- près d’1/4 des litiges déclarés pour des chiens et chats.
Analyse des experts
Marie-Emilie Petigny & Blanche Rolo-Evezard, Juristes MACSF
Dr Michel Baussier, Docteur vétérinaire, consultant MACSF
Chez les chiens et les chats, la stérilisation des femelles reste une source importante de litiges.
La MACSF a par ailleurs observé une hausse importante des sinistres liés à des actes de médecine canine et féline, dont beaucoup concernent des actes de diagnostic. Les actes de suivi et la prescription de médicaments complètent le podium. Deux dossiers ont concerné des actes de vaccination. Un acte d’ophtalmologie et une infection nosocomiale ont également fait l’objet de réclamations.
La chirurgie intéresse 1/4 des litiges, la chirurgie orthopédique étant peu représentée, alors que les dossiers d’anesthésie représentent 5% des déclarations de vétérinaires spécialisés dans les animaux de compagnie.
Le taux de sinistralité engendré par la rédaction de certificats reste faible depuis plusieurs années, des modèles étant proposés par les instances professionnelles.
En 2024, aucun litige n’a été déclaré concernant la garde ou la contention des animaux de compagnie, contrairement aux bovins concernés par deux sinistres liés à la contention.
Parmi les litiges intéressant les bovidés, plus de 40% découlent de la réalisation de césariennes.
Outre les réclamations pour des actes liés à la reproduction des bovins, un litige sur 6 fait suite à des actes de médecine (diagnostic, suivi) ou d’anesthésie. En 2024, la MACSF a enregistré 3 réclamations faisant suite à la mort de bovins soignés par drenchage contre une seule en 2023.
Enfin, en 2024, alors que 145 litiges ont été réglés amiablement par la MACSF, deux ont été portés devant la juridiction civile, un devant le Conseil de l’Ordre et une plainte pénale a été déposée pour maltraitance animale.
Animaux de rente
Équins
Reproduction
- Erreur d'insémination
Une jument est inséminée en mars 2023 avec la paillette d’un mauvais étalon. Le poulain né de cette insémination n’est donc pas le poulain attendu. Il s’agit d’une erreur d’insémination, c’est une faute lourde de conséquences.
La responsabilité est engagée.
Médecine
- Perforation lors d’une échographie
En réalisant une échographie sur une ponette, le praticien a perforé le rectum de l’animal. C’est un accident malheureusement assez classique. S’ensuit la mort de l’animal qui est directement liée à cet acte.
La responsabilité du praticien est engagée.
Bovins
Obstétrique
- Péritonite
Le praticien réalise une césarienne sur une vache. L’intervention se déroule sans difficulté. Le veau est sorti vivant. Dix jours plus tard, la vache semble fatiguée, a moins d’appétit et produit moins de lait. L’éleveur lui administre des antibiotiques pendant cinq jours. Quelques jours plus tard, un abcès sur la plaie est ponctionné et nettoyé par l’éleveur, sans visite du vétérinaire. La vache ne se lève plus. Le vétérinaire, appelé tardivement, trouve une vache en état de choc, couchée et en hyperthermie. À la fouille rectale, il existe des adhérences typiques d’une péritonite généralisée. Devant ce tableau clinique défavorable, il est décidé de ne pas engager de frais sur l’animal. La vache meurt le lendemain. L’autopsie confirme la péritonite généralisée. L’origine de la péritonite est difficile à établir en raison du stade avancé auquel la vache a été revue par le vétérinaire. Il est regrettable que l’éleveur n’ait pas appelé son vétérinaire pour diagnostiquer plus précocement l’origine du problème. Cela a potentiellement occasionné une perte de chance pour l’animal.
Il ressort du dossier qu’aucune faute du vétérinaire n’a été relevée, notamment aucun défaut de suture n’a été mis en évidence lors de l’autopsie. L’obligation de moyens a été respectée.
La responsabilité du vétérinaire n’est donc pas engagée.
- Abcès de paroi (non fautif)
Un éleveur de vaches charolaises contacte son vétérinaire pour un vêlage. Le veau ne s’engage pas en raison d’une disproportion fœto-pelvienne. Une césarienne est réalisée. L’intervention se déroule classiquement sans problème particulier. Le veau est sorti vivant. La suture utérine est réalisée avec deux surjets enfouissants, réalisés au mono-filament résorbable. La suture péritonéale et musculaire est faite au fil tressé résorbable. La vache reçoit également une couverture antibiotique. Les suites sont bonnes. Les jours suivants, la vache ne mange plus et présente un transit ralenti. Un traitement est mis en place. Un abcès de la paroi est drainé et rincé. Aucune amélioration nette n’est observée. Une laparotomie est réalisée sur la plaie de la césarienne et met en évidence un abcès de paroi profond et une péritonite avancée. L’animal meurt dans les jours suivants.
L’abcès de la paroi fait partie des complications connues de la césarienne. En l’occurrence, les bonnes pratiques chirurgicales avaient bien été respectées par la vétérinaire. Il s’agit d’un aléa dont elle n’est pas responsable.
Sa responsabilité n’est donc pas engagée.
- Abcès de paroi (fautif)
Le vétérinaire intervient pour une césarienne sur une génisse. L’intervention se déroule classiquement. Le veau est sorti vivant et les sutures utérines et cutanées ne posent pas de problème. L’animal est mis sous antibiotiques. Deux semaines plus tard, la vache mange moins et présente une plaie abdominale gonflée. Le praticien constate un volumineux abcès de paroi sans signes de péritonite. Le traitement antibiotique est instauré de nouveau. Dans le mois qui suit, la vache est examinée à plusieurs reprises pour cet abcès. Celui-ci progresse vers l’aisselle gauche. Cet abcès constitue un aléa opératoire. Toutefois, il ressort du dossier que l’anesthésie locale de l’animal a été réalisée avant la tonte et la désinfection de la zone opératoire. Le praticien a piqué à plusieurs reprises la paroi musculaire avec la même aiguille, traversant une peau potentiellement souillée. Cette manœuvre a pu permettre l’inoculation dans le muscle de germes présents à la surface de la peau. Il est impossible de connaître la voie d’entrée du germe mais la pratique du vétérinaire est un facteur de risque aggravant.
La responsabilité du praticien a ici été retenue pour ce manque de prudence et de rigueur.
- Défaut de suture
Le vétérinaire intervient pour un vêlage dystocique. Une césarienne est réalisée. Pendant l’intervention, la vache présente de nombreux efforts expulsifs, extériorisant le rumen, retardant et compliquant l’incision utérine. Le veau est extrait et réanimé. La vache se couche ensuite, compliquant la réalisation des sutures utérines. Une perfusion et un anti-inflammatoire sont administrés. La vache meurt deux jours plus tard.
L’autopsie met en évidence un défaut de suture utérine à l’origine d’une péritonite fibrino-congestive généralisée.
Lors d'une chirurgie, le praticien se doit de réaliser des sutures étanches, solides et hémostatiques. Aussi, le défaut majeur d’étanchéité des sutures utérines constitue un manquement à l’obligation de moyen du praticien.
Sa responsabilité est retenue pour défaut d’étanchéité des sutures utérines.
- Technique de surjet
Le vétérinaire intervient pour le vêlage d’une génisse croisée limousine. Le veau est en présentation postérieure. Le praticien décide de pratiquer une césarienne. L’opération se déroule dans de bonnes conditions. Le lendemain, l’état de l’animal inquiète l’éleveur. La vache meurt dans l’après-midi avant que le vétérinaire n’ait le temps d’intervenir. À l’évidence, la génisse est morte des suites d’une hémorragie de l’utérus manifestement située sur la plaie utérine. La rupture de l’unique surjet posé sur la plaie chirurgicale, immédiatement après l’intervention, a contribué à une très mauvaise hémostase de ladite plaie. La technique opératoire ne correspond pas aux pratiques qui font consensus aujourd’hui.
Sans être, en soi, fautive, la technique de surjet unique présente un risque supérieur.
La responsabilité est engagée.
- Plaie intestinale
Un vétérinaire réalise une césarienne sur une génisse car les voies génitales de l’animal s’avèrent insuffisamment dilatées. L’extraction du veau se fait sans difficulté. Le lendemain, l’animal est prostré. Un drenchage est réalisé par le praticien qui administre corticoïdes et antibiotiques. L’analyse de sang montre une calcémie basse sans anémie et permet d’écarter l’hypothèse d’une hémorragie interne. Malgré les soins, la vache meurt dans l’après-midi. Lors de l’autopsie, il ressort que la vache est morte d’une plaie intestinale qui trouve son origine dans un geste malencontreux du vétérinaire. Une anse intestinale s’est probablement intercalée entre l’utérus et l’utérotome et a été lésée par l’instrument du praticien.
La responsabilité du vétérinaire est donc retenue.
- Réaction aux huiles essentielles
Le vétérinaire examine une vache blonde d’Aquitaine le lendemain d’une césarienne. Elle présente une rétention placentaire partielle. Le restant de délivrance est extrait sans difficulté. Une injection d’antibiotiques est réalisée. Afin de prévenir une éventuelle métrite, le praticien utilise 30ml d’une solution à base d’huiles essentielles commercialisée par la société HUV Gentiana. Dans les suites immédiates, la génisse présente des signes de choc avec insuffisance cardiorespiratoire. Elle meurt très rapidement. À l’examen, une importante collection séro-hémorragique est retrouvée dans l’utérus. L’animal a succombé à un choc anaphylactique, à la suite de l’intervention du vétérinaire. Deux préparations ont été utilisées : d’une part l’antibiotique dont la pénicilline aurait pu être à l’origine du choc car le phénomène est rare mais décrit. Cependant, la collection séro-hémorragique présente dans l’utérus indique plutôt une réaction locale à l’administration des huiles essentielles.
Ces produits n’ont fait l’objet d’aucune évaluation prévue par la réglementation des médicaments vétérinaires et ne disposent donc pas d’AMM. Leur utilisation relève de l’entière responsabilité du vétérinaire qui les administre.
La responsabilité du praticien est donc retenue.
- Torsion de matrice
Le vétérinaire intervient pour le vêlage d’une vache qui présente une torsion utérine. La césarienne est réalisée et le veau meurt. La matrice est détordue et la séreuse est suturée en raison d’une déchirure pendant l’extraction. Le lendemain, alors que la vache a délivré et n’a présenté aucun symptôme inquiétant, elle est retrouvée morte. Lors de l’autopsie, l’expert retrouve une artère utérine rompue près du ligament ovarique ainsi qu’une zone déchirée sur l’utérus. La vache est morte d’une hémorragie. Il est très probable que l’hémorragie s’est déclenchée à distance de l’intervention en raison d’une nécrose secondaire des tissus. Cette évolution ne pouvait pas être anticipée dans la mesure où la vache allait bien le lendemain de l’intervention.
Le vétérinaire ne peut être tenu responsable de cet aléa survenu sur une matrice fragilisée par la torsion.
Sa responsabilité n’est donc pas engagée.
Hors obstétrique
- Castration
Le vétérinaire réalise dix castrations dites "sanglantes" sur des broutards. L’hémostase et la section des testicules sont obtenues par torsion au torchon. À la fin de l’intervention, les dix animaux reçoivent un sérum antitétanique et un anti-inflammatoire. Quelques jours après, l’un des broutards est retrouvé mort. L’autopsie réalisée révèle un saignement important au niveau de la plaie de castration, responsable d’une anémie ayant entraîné la mort. L’examen montre une section par torsion trop basse du cordon spermatique ayant empêché la bonne hémostase du pôle vasculaire.
La réalisation de l’acte est donc directement responsable du défaut d’hémostase.
La responsabilité du praticien est engagée.
- Erreur de prescription
Le vétérinaire rédige une ordonnance pour le traitement d’une mammite sur une vache. Il prescrit notamment une suspension intra mammaire antibiotique. Malencontreusement, il inverse le délai d’attente pour le lait (6 jours) et pour la viande (3 jours). Par la suite, ce médicament sera de nouveau prescrit pour d’autres vaches, cette fois avec les bons délais d’attente sur les ordonnances. Toutefois, la trace d’inhibiteurs est relevée dans le tank livré à la laiterie. Le lait livré ne peut donc plus être utilisé par la laiterie et sera détruit, sans que l’éleveur soit payé. L’identification de la molécule présente dans le lait n’est pas effectuée par le laboratoire. Toutefois, il convient de reconnaitre que, sauf à mettre en cause les dires de l’éleveuse, l’erreur sur l’ordonnance est la plus probable explication de la présence d’inhibiteurs dans le lait.
La responsabilité du praticien a ici été retenue pour ordonnance erronée.
- Drenchage
Le vétérinaire prend en charge une vache qui présente une mammite type colibacillaire aigue sévère. L’animal est couché et une perfusion associant un traitement antibiotique et antiinflammatoire est administrée. L’animal est ensuite "drenché". Au retrait de la sonde, la vache tousse, recrache du liquide et meurt dans l’heure. L’autopsie réalisée confirme la mort par asphyxie à cause d’une mauvaise déglutition du produit de drenchage. La présence de la solution de drenchage dans les poumons de l’animal indique qu’une partie du liquide est passée dans les poumons, soit par mauvais positionnement de la sonde, soit par reflux pour trop-plein de l’œsophage vers les bronches.
Quoi qu’il en soit, la réalisation technique de cet acte est de la responsabilité du vétérinaire.
- Contention
Le vétérinaire réalise une série de castrations sur huit broutards, accompagné d’un stagiaire de l’école vétérinaire. Lors de l’intervention, les broutards sont placés dans une cage à contention, attachés à la tête par un licol et le postérieur droit maintenu vers l’avant par une corde au jarret. Chaque animal reçoit une injection épidurale avant la castration dite "sanglante". Le troisième broutard est plus agité, les cordes sont libérées après la péridurale. Les cordes sont finalement rattachées et l’intervention débute. Au moment de la torsion testiculaire, l’animal se couche. Il se relève quelques minutes plus tard, permettant de constater la fracture du postérieur gauche. Suite à un mouvement de l’animal, la facture s’ouvre. L’animal sera euthanasié.
La castration est une intervention à visée zootechnique et non médicale, parfois dite de convenance et soumise à une obligation de résultat sur la finalité de l’intervention. Compte tenu du transfert de garde pendant l’intervention, le praticien est responsable des dommages causés à l’animal. Ici, les règles de sécurité pour obtenir une contention adaptée ont été parfaitement respectées.
La réaction de l’animal était totalement imprévisible et irrésistible.
La responsabilité du praticien n’est pas engagée dans la mesure où il s’agit d’un aléa.
Animaux de compagnie
Chats et chiens
Reproduction
- Péritonite suite à une hystérectomie
Le vétérinaire réalise une stérilisation sur une chienne Shetland. Quelques mois plus tard, la propriétaire signale des chaleurs. Il est convenu de réopérer gratuitement la chienne. Entre-temps, elle est cédée et réopérée, mais aucun résidu d’ovaire ni ovaire ectopique n’est identifié. L’utérus est retiré par sécurité. Un traitement antiinflammatoire et antibiotique est instauré. Quelques semaines plus tard, la chienne présente des signes d’altération de son état général. Une péritonite est détectée. Une hospitalisation et un traitement antibiotique sont instaurés.
L’ovariectomie chez la chienne est une intervention dite de convenance, qui consiste à retirer les ovaires d’une chienne pour empêcher les manifestations de chaleurs et annihiler le risque de gestation. Il arrive qu’en ligaturant de part et d’autre de l’ovaire, le praticien en laisse un résidu minime. Ces cellules résiduelles sont capables de reformer un nodule secrétant des hormones. Celles-ci sont responsables des manifestations de chaleurs observées. L’ovulation est impossible, donc aucune gestation n’est à craindre. Cependant le risque de tumorisation de ces cellules est accru, la correction chirurgicale est donc de mise. La stérilisation est une opération soumise à une obligation de sécurité de résultat et non à une seule obligation de moyens. Dans le cas de cette chienne, aucun résidu n’a été observé, c’est pourquoi l’utérus a été ôté pour empêcher toute production d’hormone par cet organe. Les tissus ôtés n’ont pas fait l’objet d’une analyse histologique permettant d’identifier d’éventuels tissus sécrétants. Néanmoins, la péritonite constitue un aléa thérapeutique.
La responsabilité du vétérinaire n’est pas engagée.
- Éviscération suite à la stérilisation d’une chienne
Lors de la stérilisation d’une chienne, l’abord se fait par la ligne blanche et aucun incident per-opératoire n’est à signaler. Les sutures musculaires et cutanées sont faites en surjets simples. La chienne est équipée d’un body protecteur. L’animal est revu avec une petite collection séreuse sans gravité au troisième jour. Toutefois, la chienne présente par la suite une éviscération de 2 cm. Une chirurgie de reprise des plaies musculaires, sous-cutanées et cutanées est effectuée avec nettoyage des viscères. La propriétaire de la chienne sollicite le remboursement des frais supplémentaires. Les sutures n’ont pas été suffisamment serrées pour éviter le passage d’épiploon dans la plaie opératoire à travers les surjets, justifiant la reprise chirurgicale de la plaie. Or, le praticien se doit de réaliser des sutures étanches, solides et hémostatiques.
Le vétérinaire a donc failli à son obligation de moyens en réalisant des sutures imparfaites.
Sa responsabilité est engagée.
- Castration sans accord
Une association amène un chat errant pour stérilisation. Le vétérinaire ne détecte pas de puce électronique lors de la vérification. Le chat est donc castré et déparasité. Le lecteur est repassé plus tard et la puce est détectée. La propriétaire est contactée et la situation lui est expliquée. Elle n’accepte pas la situation et insulte, menace et filme le personnel de la clinique. Elle dépose plainte devant le tribunal judiciaire pour acte de cruauté et maltraitance. Quoi qu’il en soit, le chat a été castré sans l’accord du propriétaire. Cela est fautif bien que le vétérinaire ait pris soin de passer le détecteur de puces électroniques.
La responsabilité du vétérinaire est retenue alors que l’intervention a été réalisée dans des conditions optimales et que la castration n’altère en rien l’espérance de vie du chat.
Médecine
- Bronchopneumopathie chez un chien
Le vétérinaire examine un border collie de 9 ans qui présente une toux sèche et quinteuse. La radio réalisée montre une cardiomégalie et un épaississement bronchique. Un traitement antibiotique et antiinflammatoire est mis en place. La coprologie révèle la présence de parasites intestinaux susceptibles d’avoir des migrations pulmonaires. Un traitement est mis en place. L’échographie cardiaque réalisée dans les suites montre une endocardiose mitrale gauche précoce. Une bronchite infectieuse ou parasitaire est donc suspectée et un traitement est instauré. Un contrôle dans 6 mois est conseillé. Des mois plus tard, le chien est revu pour troubles digestifs, larmoiements et toux. L’auscultation révèle une évolution du souffle. La propriétaire de l’animal refuse l’échocardiographie de contrôle. La coprologie refaite revient de nouveau positive malgré les traitements. Un nouveau traitement antiparasitaire est donc mis en place. Un mois plus tard, le chien présente une toux chronique. La radio montre une trachée très déviée par la taille augmentée du cœur. En clinique, le chien est revu et le praticien réaffirme son hypothèse d’une origine compressive de la toux par dilatation cardiaque. Sans exclure la bronchite, il ne préconise aucun traitement. Plusieurs mois plus tard, le chien présente une crise de toux qui nécessite un traitement antibiotique et par cortisone permettant une régression. Six mois plus tard, le même traitement est instauré pour les mêmes symptômes. La radio révèle une bronchite chronique. L’antibiothérapie est maintenue. L’état du chien ne s’améliore pas. Il est pris en charge en clinique et une broncho-pneumonie d’étiologie inconnue est diagnostiquée. Le chien présente un décompensation multi-organique majeure malgré la mise sous ventilation mécanique. L’animal meurt d’un arrêt cardio-respiratoire. Aucune autopsie n’est réalisée. La propriétaire de l’animal reproche un retard de diagnostic de la bronchopneumopathie. Or, le praticien a réalisé tous les examens et traitement dont il disposait. Il a, à chaque fois que cela semblait nécessaire, référé l’animal vers un pôle de compétences. Le chien présentait bel et bien une pathologie cardiaque pouvant expliquer la toux (par compression de la bronche souche gauche) qui a pu favoriser l’installation tardive d’une surinfection qui a été fatale à l’animal.
Le vétérinaire a répondu à son obligation de moyens et n’a commis aucune faute.
Sa responsabilité n’est donc pas engagée.
- Contre-indication médicamenteuse
En complément d’une césarienne, une chienne subit une ovario-hystérectomie. Un traitement par PREVICOX® est mis en place sans que la propriétaire de l’animal soit informée de sa contre-indication durant la lactation. Les chiots ont donc présenté des troubles digestifs à quatre jours de vie. L’un des trois chiots meurt. Le rôle de ce traitement dans la survenue des symptômes n’est pas évident à établir en raison de l’absence d’étude sur le passage de la molécule dans le lait maternel. Cependant, au vu des contre-indications clairement explicitées dans le RCP et dans le contexte amiable, le bénéfice du doute a été ici profitable à la propriétaire.
La responsabilité du vétérinaire a été retenue.
Certificats, formalités
- Certificat vétérinaire avant cession d’un chiot
Le vétérinaire rédige un certificat de cession pour un chiot mentionnant l’absence de descente des testicules. Le chiot est acheté et sa nouvelle propriétaire l’emmène en consultation. Lors du rendez-vous, le vétérinaire découvre une imperforation du conduit auditif qui n’avait pas été signalée sur le certificat de cession. La propriétaire demande donc le remboursement des frais vétérinaire relatifs à cette anomalie.
La responsabilité du vétérinaire est engagée en raison d’un examen insuffisamment attentif.
- Formalités pour un voyage
À l’occasion d’un voyage de l’Union Européenne vers l’Angleterre, tout propriétaire d’un carnivore domestique doit s’acquitter de plusieurs formalités, à savoir : l’animal doit être âgé de plus de 15 semaines, être identifié, présenter un passeport européen ou bien un certificat sanitaire, avoir été vermifugé contre les ténias à l’aide de Praziquentel entre 12 et 24 heures avant le départ et être à jour de la vaccination contre la rage. Or, les vaccins de la chienne, suivie régulièrement à la clinique vétérinaire, n’ont pas été vérifiés. Le vaccin contre la rage n’était pas à jour à la date du départ en Angleterre. L’accès au ferry est donc refusé par la douane.
La responsabilité du vétérinaire est engagée.
Anesthésie
- Manœuvres de réanimation
Dans le cadre du dépistage de la dysplasie des hanches et des coudes, et de l’ostéochondrite disséquante des épaules, une anesthésie est réalisée afin d’effectuer les radiographies. Le cathéter est posé sans problème. Une fois la radio effectuée, le vétérinaire stoppe l’apport en gaz anesthésique. Durant la radiographie du coude et de l’épaule gauche, la chienne fait une apnée. Voyant que la chienne ne respire pas, le vétérinaire réalise quelques manœuvres de respiration artificielle avec masque et ballon et complète par une dizaine de mouvements de pression sur la cage thoracique. Malgré ces mesures, la chienne ne respire plus et meurt. Aucun signe d’insuffisance cardiaque n’avait été mentionné dans le dossier de l’animal. De plus, les doses administrées pour la sédation sont correctes. Toutefois, les manœuvres de réanimation ont été limitées et ont été rapidement interrompues. Ces manquements sont considérés comme fautifs.
La responsabilité du praticien est engagée.
Chirurgie
- Oubli de compresse lors de la stérilisation d'une chienne
Le vétérinaire réalise la stérilisation d’une chienne avant d’être cédée. La chienne effectue des mictions sur le canapé et des compléments alimentaires à base de canneberge sont prescrits. Une échographie est réalisée, permettant de mettre en évidence une masse en arrière de la vessie. Un traitement antibiotique et antiinflammatoire est prescrit et suivi, en l’absence d’amélioration, par un traitement pour incontinence. Toutefois, la masse grossit. Une exérèse est alors réalisée. L’analyse histologique montre un amas de tissu graisseux autour d’un corps étranger tissulaire. Une compresse a été laissée dans l’abdomen. Cet oubli de compresse est une faute chirurgicale. L’obligation de moyens n’a pas été respectée.
La responsabilité du praticien est engagée pour faute chirurgicale.
- Corps étranger
Un chien est vu en consultation pour une plaie sublinguale provoquée par un morceau de bois avec lequel il jouait. La plaie est suturée sous anesthésie générale sans découvrir de corps étranger. Dans les jours suivants, une masse volumineuse au niveau du cou convainc la propriétaire de consulter à nouveau. Un abcès est diagnostiqué et drainé. Le chien est placé sous antibiotique et anti-inflammatoire. Une nouvelle masse apparaît le mois suivant. Le chien est pris en charge dans une autre clinique et un morceau de bois de 2cm est découvert au niveau de l’abcès. L’absence de recours à un examen d’imagerie lors de la deuxième prise en charge peut être considérée comme un défaut de moyens.
La responsabilité du vétérinaire est engagée.
- Infection nosocomiale
Le vétérinaire réalise une ovariectomie de convenance pour une chienne Rottweiler d’un an. Elle est anesthésiée classiquement. Elle est ensuite intubée, puis un relais de gaz anesthésique (isoflurane) est mis en place. Une tonte large centrée sur l’ombilic est réalisée. La zone est ensuite désinfectée à l’aide de deux désinfectants (chlorhexidine solution et chlorhexidine savon). Les ovaires sont extériorisés et des ligatures au niveau des pôles vasculaires ovariens et utérins sont réalisées à l’aide d’un fil tressé résorbable. Après s’être assuré d’une absence de saignement dans la cavité abdominale, le péritoine et les plans musculaires sont refermés à l’aide d’un surjet simple avec deux nœuds d’arrêt. Le tissu sous-cutané est suturé avec un surjet simple. La peau est quant à elle suturée à l’aide d’un surjet simple avec deux points d’arrêt. Une injection d’anti-inflammatoire non stéroïdien et une injection d’antibiotiques sont réalisées en postopératoire. Le réveil est calme et sans incident. Une collerette est mise en place. Un anti-inflammatoire non stéroïdien est prescrit pour le retour à la maison pendant trois à cinq jours en fonction de la douleur. En postopératoire, une plaie cutanée est suintante. Une antibiothérapie à large spectre est mise en place. Par la suite, une déhiscence de la plaie est observée par les propriétaires. La plaie est alors reprise. Le chirurgien retrouve beaucoup de tissus inflammatoires, voire nécrotiques, et de liquide sous la peau. La paroi musculaire semble en bon état. Lors du contrôle, le vétérinaire constate une déhiscence des sutures musculaires. La chienne est alors référée pour une prise en charge chirurgicale. La laparotomie exploratrice montre une éventration avec lâchage des sutures musculaires sur territoire infecté. Un prélèvement bactériologique sur liquide abdominal pour analyse au laboratoire met en évidence de nombreuses colonies bactériennes, avec comme germes Staphylococcus aureus et Staphylococcus pseudintermedius, résistants à de nombreux antibiotiques. Les tissus qui semblent macroscopiquement infectés, notamment au niveau de la paroi musculaire, du tissu sous-cutané et de la peau, sont retirés. Il y a une faible quantité de liquide purulent et une absence de congestion des différents viscères abdominaux. Un rinçage abdominal est réalisé. Le site chirurgical est refermé et suturé de façon classique, sans pose de drain abdominal.
Une surveillance accrue est instaurée et les points de suture sont retirés dans les 15 jours suivant l’intervention.
La bactériologie a mis en évidence deux agents pathogènes bactériens à la suite de l’intervention de convenance. Il s’agit d’une infection nosocomiale. La contamination a pu se faire via un défaut de désinfection, les mains, le matériel ou bien l’environnement... Les mesures d’hygiène des mains, du matériel et des locaux sont essentielles afin d’éviter ce type d’infection. Or, il s’agit d’une intervention de convenance.
Dans ce contexte, le vétérinaire a une obligation de sécurité de résultat. La responsabilité du praticien est retenue.
- Défaut d'information lors d'une extraction dentaire
Un chat Maine Coon d’un an et demi est pris en charge pour un détartrage car il présente une gingivo-stomatite avec tartre et douleurs dentaires. Lors de l’intervention, des lésions de caries sont mises en évidence sur la majorité des molaires et prémolaires avec perte de substance. L’extraction de toutes les dents, hormis les crocs, est préconisée. La propriétaire de l’animal reproche une exérèse incomplète des racines dentaires. En effet, le fait de laisser un bout de racine constitue une faute. Cependant, dans ce cas, l’extraction a été rendue difficile du fait de la perte de substance importante au niveau de ses dents générée par la pathologie de ce chat. L’intervention d’un spécialiste était donc indispensable mais pas identifiable avant le détartrage. Si le praticien avait directement référé les propriétaires vers un spécialiste, seules deux consultations auraient pu être évitées. Mais les frais engagés chez le spécialiste auraient été exactement les mêmes.
La responsabilité du praticien est retenue pour défaut d’information sur les risques de complication.
Le saviez-vous ?
Des décisions de justice et des avis CCI
ont été rendus en 2024 dans votre spécialité.
Découvrez les éléments-clés
(nombre de mis en cause, taux de condamnation, montants d'indemnisation)