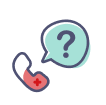Une loi adoptée au terme d'un long processus législatif
Suite au lancement par le Gouvernement d’un plan national pour la sécurité des professionnels de santé en 2023, l’ancien député Pradal a déposé, en janvier 2024, une proposition de loi. Ce texte visait à renforcer la répression des violences commises contre des professionnels de santé et personnels des établissements de santé et médico-sociaux, mais également contre des professionnels libéraux.
Il a été voté et adopté à l’unanimité par les députés le 14 mars 2024 mais la navette parlementaire n’a repris que le 6 mai 2025 avec son inscription à l’agenda du Sénat. À la demande du Gouvernement, une procédure accélérée a été mise en place :
- une lecture dans chaque chambre ;
- une Commission mixte paritaire (CMP) convoquée pour aboutir à un texte commun, une fois le passage au Sénat terminé.
Un accord en CMP a été trouvé le 20 mai 2025.
La proposition de loi a ensuite été définitivement adoptée par l’Assemblée Nationale le 25 juin 2025 par 135 voix pour et 27 voix contre, et promulguée le 9 juillet 2025.
Une protection étendue à tous les professionnels exerçant dans le domaine du soin
Initialement limitée aux professionnels des établissements de santé, la protection s’applique désormais à un large éventail de professionnels :
- tous les professionnels de santé, et ce, quel que soit leur statut (hospitaliers, salariés, libéraux, prestataires à domicile) ;
- le personnel administratif et technique travaillant dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ;
- le personnel des officines de pharmacie, des laboratoires de biologie médicale, des maisons de naissances ;
- les infirmiers ou kinésithérapeutes effectuant des soins à domicile…
Sont ainsi concernés l’ensemble des professionnels exerçant dans :
- un établissement de santé,
- un centre de santé,
- une maison de santé,
- une maison de naissance,
- un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé,
- une officine de pharmacie,
- un prestataire de santé à domicile,
- un laboratoire de biologie médicale,
- un établissement ou un service social ou médico-social.
Des sanctions pénales aggravées
La loi prévoit une modification du code pénal, avec des peines aggravées à l’encontre des auteurs de violences commises sur les professionnels de santé et le personnel des structures de santé, sociales et médico-sociales en intégrant les prestataires de santé à domicile.
Violences physiques et verbales
La loi prévoit un alourdissement des peines pour les violences physiques ou verbales commises sur un professionnel de santé, notamment en cas de blessures graves ou d’interruption temporaire de travail.
Par exemple, en cas de violences physiques ou verbales contre une infirmière ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, les peines maximales encourues sont portées de 3 à 5 ans d’emprisonnement et de 45 000 à 75 000 euros d’amende.
Violences sexuelles
Les violences sexuelles constituent des circonstances aggravantes lorsqu’elles sont commises dans un lieu de soin ou au domicile du patient.
Vol
Le vol de matériel médical ou de documents professionnels (ordonnancier, tampon professionnel…) est également plus sévèrement puni.
Un délit d'outrage étendu
Le délit d’outrage, auparavant sanctionné uniquement quand il était commis à l’encontre des professionnels de santé exerçant une mission de service public, est désormais élargi à l’ensemble des professionnels exerçant dans les structures énumérées à l’article 1er ou au domicile du patient.
De lourdes sanctions sont prévues en cas d’outrage à l’encontre d’un professionnel exerçant dans le domaine de la santé : 7 500 euros d’amende et une peine complémentaire d’emprisonnement de 6 mois.
Les conseils nationaux des sept Ordres des professions de santé ont désormais la faculté de se constituer partie civile en cas d’outrage (tout comme pour la menace) commis à l’encontre d’un de leurs membres.
Un dépôt de plainte facilité
Dans son dernier rapport 2022 (données 2020 et 2021), l’Observatoire National des Violences en milieu de Santé (ONVS) met en exergue le faible nombre de dépôts de plaintes des personnels de santé notamment en raison "de fortes réticences à s’engager dans un processus judiciaire".
Pour lutter contre ce phénomène, la loi Pradal facilite l’accompagnement judiciaire des victimes.
Professionnel de santé salarié ou hospitalier
Il est désormais possible pour l’employeur d’un professionnel de santé, lorsqu’il a connaissance de faits de violence commis contre un agent de sa structure de soins ou médico-sociale, de déposer plainte à sa place sous certaines conditions (article 5) :
- le consentement écrit de la victime est obligatoire ;
- la plainte est limitée à certaines infractions spécifiques, notamment des violences graves (violences physiques, menaces, dégradations…) commises dans un cadre professionnel ou en raison des fonctions du professionnel de santé ;
- le dépôt de plainte par l’employeur ne fait pas de lui la victime directe, il ne peut donc pas engager seul la procédure ni se constituer partie civile sauf s’il est lui-même lésé ;
- sont exclues les violences commises entre membres du même service pour éviter tout conflit interne.
L’objectif poursuivi est d’encourager le signalement des violences et d’alléger la charge émotionnelle qui pèse sur les victimes.
Enfin, il est à noter que dans les suites de la décision n°2024-1098 du 4 juillet 2024 du Conseil Constitutionnel, le régime de protection fonctionnelle bénéficie désormais aux agents publics entendus sous le régime de l’audition libre, et ce, quel que soit leur statut au cours de l’audition (témoin simple, assisté ou mis en examen).
Professionnel de santé libéral
La faculté de déposer plainte au nom d’un libéral est désormais ouverte aux Ordres professionnels et aux unions régionales (URPS) de ces professionnels, une fois sollicités.
Tel est notamment le cas pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues.
Les professionnels de santé libéraux peuvent également déclarer leur adresse professionnelle comme domicile lorsqu’ils portent plainte. Cette mesure vise à protéger leur vie privée et éviter que leur adresse personnelle soit connue de l’agresseur présumé.