Des troubles fréquents mais encore trop invisibles
Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages, dits “troubles dys”, concernent des enfants dont les capacités intellectuelles sont normales, voire supérieures à la moyenne, mais dont le cerveau traite l’information différemment. Ces troubles forment un spectre varié, souvent méconnu du grand public comme des soignants :
- Dyslexie pour la lecture.
- Dysorthographie pour l’écriture.
- Dyspraxie pour la coordination.
- Dyscalculie pour le calcul.
- Dysphasie pour le langage oral.
En France, la Haute Autorité de Santé (HAS) estime que 10% des élèves présentent un trouble dys, dont environ 5% de dyslexiques. Ce chiffre en fait l’un des troubles du neurodéveloppement les plus fréquents, juste après le TDAH.
Pourtant, le repérage reste inégal. Beaucoup d’enfants ne sont diagnostiqués qu’après plusieurs années d’échecs scolaires, de malentendus pédagogiques et de perte d’estime de soi.
Pourquoi dépister tôt change tout
Repérer un trouble dys avant l’âge de dix ans peut transformer la vie d’un enfant. Le cerveau jeune possède une plasticité remarquable, capable de se réorganiser en réponse à des stimulations extérieures. Plus le repérage est précoce, plus il est possible d’atténuer les effets du trouble et d’éviter les conséquences en chaîne :
- retards d’apprentissage,
- fatigue cognitive,
- découragement,
- voire troubles anxieux ou dépressifs secondaires.
Une détection rapide permet d’adapter les apprentissages, de proposer des rééducations ciblées et d’équiper l’enfant d’outils de compensation efficaces : travail orthophonique, accompagnement psychomoteur, soutien numérique, aménagements scolaires. À l’inverse, un diagnostic tardif conduit souvent à un sentiment d’échec durable et à des troubles émotionnels difficiles à rattraper.
Détecter tôt, c’est prévenir plutôt que réparer.
—
Cette mission de repérage peut être réalisée par les infirmières de PMI, qui jouent un rôle clé dans le dépistage précoce, notamment lors des bilans de santé effectués en écoles maternelles. À cela s’ajoute le dispositif DP2O, mis en place pour le dépistage du langage et de la vision à 3 ans : les enseignants formés font passer des tests standardisés, analysés ensuite par des orthophonistes. Les parents reçoivent également une information claire sur le développement du langage et les signaux d’alerte à surveiller.
Depuis 2024, le gouvernement a fait du médecin de premier recours un acteur central du repérage précoce. Lors des consultations de suivi, un questionnaire spécifique permet de détecter d’éventuels troubles neurodéveloppementaux, dont font partie les troubles du langage et des apprentissages.
Les praticiens disposent désormais d’un outil officiel pour les aider : la grille de repérage des écarts de développement publiée par la Délégation interministérielle au handicap (DIH).
Télécharger la grille de repérage des TND avant 7 ans (version 2024)
Ce qui doit susciter le doute
Le médecin généraliste, le pédiatre ou le médecin scolaire est souvent le premier à être sollicité par les parents ou les enseignants. Pour eux, savoir reconnaître les premiers signes est primordial.
Certains antécédents doivent éveiller la vigilance, notamment lorsqu’un parent ou un frère ou une sœur présente déjà un trouble du langage ou des apprentissages.
Les difficultés apparaissent souvent dès la maternelle : un langage qui tarde à se structurer, une élocution floue, des confusions de sons ou une incapacité à les isoler. L’enfant mémorise difficilement les noms de couleurs, les jours de la semaine ou les comptines, bute sur l’alphabet ou la suite des nombres, et doit compter les points d’un dé pour reconnaître un chiffre.
Ces signes s’accompagnent parfois de troubles attentionnels, d’une impulsivité marquée, d’une gestion émotionnelle difficile ou d’une maladresse inhabituelle dans les activités manuelles et graphiques.
Pris isolément, ils peuvent sembler bénins, mais leur accumulation ou leur persistance doit alerter.
Le rôle pivot du médecin dans le parcours de soins
Son rôle est d’écouter, observer et orienter. C’est lui qui initie le parcours de soins lorsque les difficultés d’apprentissages persistent malgré un accompagnement pédagogique d’au moins six mois, ou lorsque les parents ou les enseignants signalent un retard d’acquisition durable.
Éliminer d’autres causes possibles aux troubles
Dans ce cas, et avant d’envisager un trouble “dys”, le médecin doit s’assurer qu’aucune autre cause médicale ne vient entraver le langage ou les apprentissages. En effet, ces diagnostics sont des diagnostics d’élimination.
De nombreux facteurs peuvent provoquer ou aggraver des difficultés scolaires :
- un trouble visuel non corrigé,
- un déficit auditif,
- un problème ORL chronique (amygdales volumineuses, frein de langue restrictif, allergies),
- des troubles du sommeil comme les apnées,
- une fatigue liée à des carences métaboliques.
Le médecin doit aussi examiner le développement global, rechercher un éventuel syndrome génétique ou un trouble métabolique, et s’assurer de l’absence de causes environnementales ou psychologiques.
Un dépistage méthodique de ces causes, réalisé directement ou via des examens complémentaires, permet de gagner un temps précieux dans le parcours diagnostique et d’éviter les errances médicales.
Une orientation pertinente vers les spécialistes
Une fois ces bilans réalisés, s’ils ne révèlent rien de spécifique, le médecin oriente l’enfant vers les bons spécialistes selon le trouble suspecté.
- Un orthophoniste sera sollicité pour les troubles du langage oral et écrit, les difficultés de cognition mathématique ou de graphisme.
- Un orthoptiste interviendra en cas de sauts de lignes, d’inversions fréquentes, de fatigabilité à la lecture ou de difficultés visuo-constructives.
- L’ergothérapeute prendra le relais lorsqu’un trouble du graphisme ou des coordinations gêne la vie quotidienne ou scolaire.
- Le psychomotricien sera indiqué pour les troubles moteurs globaux ou fins et les difficultés de coordination.
- Enfin, un neuropsychologue sera sollicité pour des difficultés attentionnelles, exécutives ou une suspicion de TDA/H associé.
Le cadre spécifique défini par la HAS
Depuis 2018, la Haute Autorité de Santé a défini un cadre précis.
- Le premier niveau de recours concerne les troubles simples, pris en charge localement par des spécialistes de ville, sous la responsabilité du médecin de l’enfant.
- Lorsque le diagnostic est plus complexe, une coordination pluridisciplinaire s’impose. Le deuxième niveau fait intervenir une équipe de soins associant plusieurs professionnels paramédicaux, coordonnés par un médecin référent chargé de la synthèse médicale et du projet de soins.
- Enfin, pour les situations les plus sévères ou atypiques, les Centres de Référence des Troubles Spécifiques du Langage et des Apprentissages (CRTLA), au nombre d’une quarantaine en France, assurent l’expertise et l’évaluation approfondie.
Au quotidien, le médecin reste le pivot du dispositif. Il organise les bilans, centralise les comptes rendus, informe la famille et trace les observations dans le carnet de santé. Il peut, avec l’accord des parents, communiquer à l’école les conséquences fonctionnelles du trouble afin de faciliter la mise en place des aménagements scolaires.
Un enjeu de santé publique
Les troubles dys impliquent bien au-delà du cercle familial. Autour de chaque enfant, une constellation de professionnels gravite : enseignants, médecins, orthophonistes, psychologues, AESH.
En réalité, il y a presque toujours un “dys” autour de nous, un patient, un élève, un collègue. Former les soignants au repérage, renforcer la coordination entre les acteurs et soutenir les familles, c’est permettre à ces enfants - et futurs adultes - d’apprendre et de vivre autrement, sans que leur différence ne devienne un handicap invisible.
Dépister un trouble dys, ce n’est pas seulement poser un diagnostic : c’est ouvrir la voie à la réussite et à la confiance.
Quelle prise en charge chez l'enfant et l'adulte ?
Afin d’approfondir ces enjeux et mieux comprendre les solutions existantes, découvrez le replay de notre webinaire dédié à la prise en charge des troubles dys.


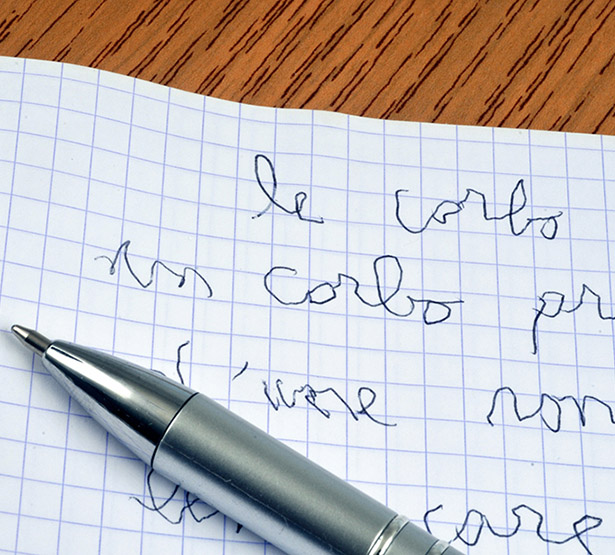


.png)












