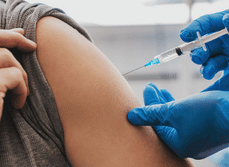Le confrère : un patient plus difficile que les autres ?
Prendre en charge un confrère pose sensiblement les mêmes difficultés que soigner un membre de sa famille ou de son entourage.
Certains savent le faire et le gérer correctement, en se protégeant et en laissant une autonomie suffisante à leur "patient confrère". D’autres ont beaucoup plus de mal à se positionner et se sentent mal à l’aise notamment avec la crainte des jugements réciproques et le fait de facturer des consultations, alors même que la prise en charge d’un confrère est plus complexe. Soigner un soignant suppose donc d’être clair par rapport à ces problématiques.
J’ai dirigé plusieurs thèses jumelles (à Paris et à Tours) sur la santé mentale des étudiants en médecine et sur la santé des médecins. Ces travaux ont notamment permis d’interroger des médecins gravement malades (suivi médical, impact sur leur exercice) et des confrères les prenant en charge.
Ce travail qualitatif a mis en évidence le fait qu’un médecin malade est davantage malade que médecin : ce "statut" l’emporte sur celui de praticien, qui peut cependant avoir une influence non négligeable, parfois péjorative. Parallèlement, pour un soignant prenant en charge un médecin malade, la position de soignant est plus prégnante que le fait que le malade soit un confrère.
Comment pourriez-vous qualifier la prise en charge des soignants souffrants ?
Elle est plus complexe et délicate qu’avec un autre patient. Être malade et accepter de se faire soigner impliquent de lâcher prise. Or, le soignant souffrant peut avoir tendance à vouloir rester dans la maîtrise donc ce n’est pas simple, d’autant que la culture du patient éduqué et responsable de sa santé s’est beaucoup développée ces dernières années.
Cette double dimension nécessite beaucoup de tact ainsi que la maîtrise d’une méta communication sur les options thérapeutiques possibles, la manière d’organiser les soins, la conduite de la relation, l’importance de l’écoute et le rappel de la confraternité.
L’annonce d’une maladie grave à un confrère peut être éprouvante et perturbante car on peut s’identifier à lui, alors qu’on ne doit pas se mettre à sa place. Être professionnel consiste précisément à le considérer comme "l’autre" et à ne pas tomber dans cette identification. C’est comme se tenir sur une ligne de crête permanente.
Comment un médecin malade se soigne-t-il ?
Il peut se prescrire des médicaments ou des examens, ou encore consulter un confrère ; ou choisir au contraire de ne pas le faire.
Cela souligne l’intérêt d’avoir un "vrai" médecin traitant qui ne soit ni un proche ni un ami.
Même si un médecin en bonne santé n’a pas vraiment de raison d’avoir un médecin traitant, lorsqu’il est ou devient malade, il peut être dans le déni, acceptable jusque dans une certaine limite, notamment en cas de maladie chronique ou grave.
Par conséquent, être sensible ou sensibilisé au fait qu’on peut être malade, c’est déjà sortir du déni et se donner la possibilité d’aller consulter un médecin dont on sait qu’il nous considérera avant tout comme un patient avec la juste distance que cela implique et non comme un collègue.
Le médecin malade peut-il réaliser ses propres prescriptions et examens ?
En théorie oui mais en pratique pas toujours. Il y a certains examens qu’il ne peut pas réaliser tout seul (examen de certaines parties du corps notamment).
Il ne peut pas non plus oublier ce qu’il sait en tant que soignant, quelle que soit la part de déni de la maladie. L’attente de résultats d’examens n’aura donc pas le même impact sur lui que sur un autre patient.
Le médecin malade n’a pas non plus nécessairement envie de regarder le détail de la composition d’un médicament et de ses effets secondaires. Il peut être tenté de le faire mais peut aussi préférer ne pas le faire et ne pas prendre la "direction des opérations", compte tenu du stress ou de l’angoisse que cela peut générer. C’est pourquoi il peut être préférable de s’en remettre au confrère prescripteur, qui est souvent mieux placé à cet égard que le soignant malade.
Le bon degré d’implication et le niveau de directivité à adopter ne sont pas toujours faciles à déterminer.
Le soignant malade a-t-il tendance à consulter plus rapidement ou plus tardivement que les autres patients ?
Il consulte souvent plus tardivement.
Les soignants qui appellent le numéro vert de l’AAPML (0826 004 580 joignable 24/7) présentent la plupart du temps des pathologies beaucoup plus avancées que les autres.
Par ailleurs, ils sont soucieux de garder la maîtrise de l’entretien, tant dans le contenu (parfois en utilisant un jargon médical) que dans la durée de l’entretien qu’ils choisissent souvent d’interrompre quand ils le décident.
Faut-il cacher le fait d’être médecin ?
Non. Ce serait, d’une certaine façon, être malhonnête vis-à-vis du confrère qui effectue la prise en charge.
Par exemple, on peut avoir du mal à gérer ou tolérer l’attente de résultats après un examen. Se trouver subitement à la place du patient peut être difficile à vivre. On comprend aussi mieux ce qu’ils vivent. Il faut donc savoir dire à un moment ou à un autre qu’on est médecin, sans non plus en faire état de façon excessive ou ostensible, ni en user comme un passe-droit vis-à-vis des autres patients.
Du point de vue du soignant, il faut réussir à "oublier" que son patient est un médecin tout en gardant à l’esprit qu’il l’est. Il y a un regard réciproque entre le "soignant soigné", soucieux de la compétence du confrère qui le soigne et de la qualité des soins qu’il reçoit, et le confrère qui le prend en charge, qui se sait observé, et qui sait qu’il ne peut pas tout à fait se comporter comme avec n’importe quel autre patient. Ce regard est particulièrement prégnant lorsqu’un médecin prend en charge un confrère d’une même spécialité.
Laisser le médecin souffrant rédiger ses propres ordonnances ne me semble pas être une bonne pratique. De même, il est très important, lorsqu’on soigne un confrère, de ne pas faire de "consultations de couloir" et de tenir un dossier médical de façon précise et rigoureuse.
Il n’est pas non plus conseillé de communiquer son numéro de téléphone portable du seul fait qu’il s’agit d’un confrère.
L’information sur la pathologie et les soins proposés est-elle différente de celle délivrée aux autres patients ?
On ne doit pas penser qu’elle peut être plus légère du fait qu’il s’agit d’un soignant disposant déjà d’un certain savoir et d’une certaine pratique.
La part de l’implicite est d’autant plus importante et le rôle du confrère prenant en charge le soignant est précisément d’expliciter ces choses qui ne sont pas dites, parce qu’elles sont difficiles, mais qui constituent des évidences.
Il s’agit, d’une certaine façon, de faire comprendre à l’autre qu’on va "faire semblant de jouer au docteur", et ce faisant, d’instaurer un rapport d’authenticité et de confiance.
Dans ce cas, la relation peut fonctionner et offre au soignant souffrant la possibilité de pouvoir exprimer ce qu’il n’a pas osé ou pas pu formuler jusqu’alors.
Est-il préférable de recourir à un confrère étranger à son cercle professionnel ?
Chacun est libre de faire comme il veut mais il est plus difficile, me semble-t-il, d’avoir du recul avec un confrère ou un collègue que l’on connaît.
Le fait de confier ses pathologies rend ces pathologies visibles pour la personne à qui le patient s’est confié. Ce regard porté est un regard professionnel et juridiquement encadré. Toutefois, travailler avec quelqu’un dont on connaît les pathologies oblige à être très rigoureux sur la confidentialité.
Nombreux sont d’ailleurs ceux qui refusent de se faire soigner par leurs correspondants ou dans l’hôpital où ils travaillent, notamment pour des raisons de confidentialité.
Faut-il établir une liste de soignants spécialisés ?
Une liste de personnes identifiées dans ce domaine serait effectivement la bienvenue, en sachant qu’un certain nombre de professionnels sont déjà très actifs en matière d’entraide, que ce soit au sein de l’Ordre ou d’associations. Mais il y a aussi tous les praticiens, qui vont être amenés, de par leur spécialité (cardiologues, gastroentérologues, psychiatres, addictologues…), à soigner des confrères. Ils ont aussi besoin d’aide pour professionnaliser leur expérience.
J’ajoute que d’autres intervenants sont nécessaires : des psychologues bien sûr mais aussi juristes, comptables, assistants sociaux…
L’identification de professionnels spécialisés pose cependant la question de la confidentialité d’une part, et des circuits courts d’autre part. Un confrère en détresse, qui a tardé pour demander de l’aide et se trouve en grande souffrance, représente un patient à risque vital et nécessite une prise en charge rapide voire immédiate. On ne peut pas le laisser livré à lui-même et lui dire simplement de prendre rendez-vous avec un psychiatre. C’est un patient prioritaire pour d’évidentes raisons médicales qui n’ont rien à voir avec un quelconque favoritisme corporatiste.
L’observance est-elle différente chez les soignants que dans le reste de la population ?
L’observance chez les soignants n’est pas très bonne et il est couramment admis que seuls 30% environ des patients prennent les traitements qui leur sont prescrits, en respectant la posologie prescrite et la durée du traitement.
Certains sont rigoureux, d’autres plus laxistes, cela dépend du comportement de chacun. Face à la maladie on n’est jamais que soi-même.




.png)