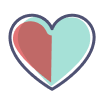Changer de spécialité : les raisons de ce choix
Paradoxalement, c’est une fois obtenue la spécialité espérée et pour laquelle ils ont tant investi pendant la préparation des EDN et ECOS que certains internes déchantent.
Une fois en stage, la réalité du terrain diffère trop de leurs attentes. Au fil des semaines et des expériences, elle engendre des doutes et une profonde remise en question qui peuvent les conduire jusqu’à faire valoir leur droit au remords.
D’autres cas de figure peuvent aussi conduire à cette décision de changement comme une mauvaise appréciation des conditions d’exercice et les difficultés à supporter le rythme et la pression dans des spécialités trop exigeantes. En ce cas, c’est la quête d’un environnement plus propice à l’équilibre et l’épanouissement personnel qui motive ce choix.
Le problème peut aussi provenir du manque d’adéquation entre la spécialité choisie et les compétences ou la personnalité des internes, du fait d’une erreur de jugement sur la spécialité, sur ses propres capacités ou encore d’un choix de spécialité mal réfléchi en raison d’un classement inférieur aux attentes.
Autant de raisons qui conduisent à une incapacité à se projeter pour de longues années dans cette spécialité médicale.
Quelques exemples pouvant motiver un changement de spécialité
Un interne appréciant le contact humain et les relations avec les patients peut être déçu par les interactions limitées retrouvées en radiologie ou en anesthésie. Les situations critiques rencontrées notamment en service d’urgences peuvent s’avérer trop angoissantes.
Spécialité médicale : le droit de se tromper
Les efforts et investissements consentis pour obtenir une spécialité sont tels que la déception et le constat d’un manque d’adéquation au cours des premiers stages d’internat peuvent être compliqués à vivre. Pourtant, ils ne doivent pas être des freins à la réflexion et au changement, tant il est crucial de ne pas s’enfermer dans une voie qui ne peut conduire à l’épanouissement professionnel à long terme.
Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez pas à en parler autour de vous, à vos responsables, vos enseignants ou même aux autres internes. Ils vous aideront à y voir plus clair et à mener la réflexion nécessaire.
Sachez aussi que vous n’êtes pas un cas isolé : chaque année, plusieurs internes font valoir leur droit au remords. Un dispositif conçu pour offrir une seconde chance et permettre de changer de spécialité en cours de formation.
Le droit au remords : conditions et limites
Le droit au remords est encadré par un corpus règlementaire, et plus précisément, par l’arrêté portant sur l’organisation du 3e cycle des études de médecine qui l’assortit d’un cadre précis, comme de certaines conditions et limites qu’il est important de connaître avant de prendre la décision de le faire valoir.
Les conditions posées au droit au remords
D’abord, l’interne optant pour un changement de spécialité n’est autorisé à le faire qu’au sein de sa subdivision d’affectation (espace géographique comprenant un ou plusieurs CHU).
Ensuite, le changement n’est possible qu’à condition que l’interne justifie d’un meilleur rang de classement aux EDN que le dernier candidat ayant intégré la nouvelle spécialité souhaitée dans la même subdivision.
Pour finir, sa demande de changement doit être effectuée au plus tard avant la fin de son quatrième semestre validé. Cette demande se fait sous la forme d’une lettre de motivation adressée à l’Agence Régionale de Santé (ARS). Elle doit être accompagnée de l’accord du coordonnateur du DES de la nouvelle spécialité souhaitée.
Les étapes à suivre
Procédure rigoureuse, le droit au remords s’effectue selon ce parcours précis :
- prise de conscience et réflexion ;
- prise de conseils et renseignements ;
- dépôt de la demande officielle ;
- examen de la demande par le comité pédagogique et éventuel entretien ;
- réaffectation.
Les limites au droit au remords
Une fois l’autorisation donnée, elle s’accompagne, selon les cas, de la prise en compte ou non des stages préalablement réalisés par l’interne dans sa spécialité initiale.
Cette décision est laissée à l’appréciation de chaque faculté et du coordonnateur de la nouvelle spécialité, du profil de l’interne, comme de la maquette de la nouvelle spécialité.
La non-validation des premiers semestres de stage a un impact sur l’ancienneté de l’interne dans sa nouvelle affectation et entraîne un décalage avec les autres internes de la spécialité. Ce qui a comme conséquences :
- le fait de passer en dernier pour le choix des stages ;
- une rémunération moindre : celle-ci étant calculée selon l’ancienneté ou nombre de stages effectués.
Ces éléments sont à prendre en compte au moment de décider ou non d’exercer votre droit au remords.
Le droit au remords permet aux internes en médecine de corriger une orientation professionnelle inadéquate. Bien qu'encadré par des conditions strictes et pouvant entraîner certaines conséquences sur l'ancienneté et la rémunération, ce dispositif permet d'éviter de s’engager dans une spécialité ne permettant pas de s’épanouir professionnellement.
Études de santé en Europe - questions fréquentes
C’est la possibilité donnée aux internes, sous certaines conditions, de changer de spécialité en cours d’internat.
Le DAR élargi permet d'accéder à une spécialité où un poste s'est libéré dans la subdivision suite au départ d'un étudiant de la même promotion durant le troisième cycle. Cette procédure permet de répondre aux besoins démographiques tout en préservant l'équilibre entre les spécialités, sans constituer un droit acquis pour les étudiants.
Les étudiants de troisième cycle peuvent demander à changer de spécialité, durant le dernier semestre de la phase socle pour les étudiants inscrits en biologie médicale, et au plus tard durant le deuxième semestre de la phase d'approfondissement pour les autres étudiants.




.png)