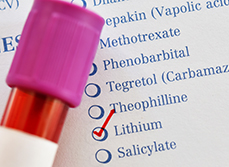Deux hospitalisations et un suicide
Une patiente de 52 ans est hospitalisée une première fois en juin 2017 au sein d’un centre hospitalier spécialisé (CHS) en raison d'un burn-out caractérisé par un épuisement physique et psychologique. Au cours de cette hospitalisation sous le régime de l’hospitalisation libre, elle fugue de l'établissement. À la suite de cet incident, l'équipe médicale décide alors de son transfert en secteur fermé.
En décembre de la même année, elle est à nouveau hospitalisée dans ce CHS, à la demande de sa fille sous le régime des soins psychiatriques à la demande d’un tiers (SPDT). La fille déclare que sa mère adopte des comportements à risque sans avoir nécessairement conscience du danger.
Six jours plus tard, la patiente obtient l'autorisation de sortir du pavillon où elle est accueillie pour se rendre dans le jardin et à la cafétéria de l'établissement, en compagnie de sa mère et de sa tante venues lui rendre visite. Cette autorisation a été délivrée sans que la fille de la patiente, qui était la référente, ne soit consultée.
Au cours de cette sortie, elle s'échappe de l'établissement, bien que ses proches aient essayé de la retenir. Elle est percutée une heure plus tard par un train sur la voie ferrée située à proximité du CHS.
Cet accident a eu de nombreuses répercussions pour la SNCF : arrêt du trafic, sécurisation des lieux, réacheminement des passagers...
Une procédure intentée par la SNCF
Dans les contentieux relatifs à des suicides, ce sont habituellement les proches de la victime qui intentent une action contre le psychiatre ou l’établissement d’hospitalisation. Ils réclament la réparation de leur préjudice moral, voire économique, du fait de la disparition d’un être cher.
Le plus souvent, ils reprochent au psychiatre :
- un défaut de diagnostic de la pathologie ou de sa gravité,
- un défaut d’hospitalisation,
- une sortie d’essai imprudente,
- un traitement inadapté,
- un défaut de consigne précise de surveillance du patient, etc.
Les reproches faits à l’établissement concernent souvent l’organisation et le personnel salarié pour :
- un défaut de surveillance,
- un défaut de détection d’une évolution péjorative de l’état du patient et donc d’alerte,
- un non-respect des prescriptions ou des consignes de surveillance,
- les procédures de surveillance ou la sécurité des locaux.
Or, dans l’affaire présentée, c’est la SNCF qui va demander réparation de son préjudice économique subi du fait de cet accident grave interrompant la circulation des trains. Cette procédure administrative est dirigée contre le CHS et son assureur et non contre les soignants ou les médecins ayant eu en charge cette patiente.
Cette demande est rejetée par le tribunal administratif (TA) en janvier 2024, peut-être en raison de son caractère atypique. La SNCF relève appel.
Les arguments de la SNCF
Elle soutient que :
- La responsabilité pour faute du CHS est engagée pour défaut de surveillance de la patiente, placée sous le régime d'hospitalisation sans consentement, qui n'en était pas à sa première tentative de fugue et de suicide. Ce raisonnement est basé sur une obligation particulière de surveillance des patients sous contrainte (sans que l’on en connaisse précisément les contours) et sur le caractère prévisible du suicide en raison d’une première tentative (selon une jurisprudence bien établie).
- Cette faute aurait occasionné des dommages aux biens ferroviaires qui s'élèveraient à une somme d’un peu plus de 17 000 €.
La réponse du CHS et de son assureur
Ils font valoir que la preuve des fautes reprochées n’est pas rapportée alors que nous sommes sur la base d’une responsabilité pour faute. Selon eux, on ne peut pas déduire de la fugue et du suicide un défaut de surveillance, comme on ne peut pas déduire du suicide son caractère prévisible.
C’est face à ces conclusions que la Cour Administrative d’appel (CAA) a rendu sa décision le 9 avril 2025.
Une exigence de surveillance mal précisée
La question posée était simple : cette autorisation de sortie (accompagnée) du bâtiment fermé, tout en restant dans l’enceinte de l’établissement, constitue-t-elle une faute ?
La CAA s’est ainsi prononcée : "Compte tenu de l'état de santé de la patiente et du risque de fuite qu'elle présentait, le CHS se devait de prendre des mesures particulières de surveillance pour éviter une telle récidive de fugue".
Le principe énoncé n’a rien d’étonnant mais est particulièrement laconique puisqu’il n’y a aucune précision sur le contenu des "mesures particulières de surveillance". Nous aurions aimé savoir si la sortie d’un bâtiment fermé est envisageable en CHS et, si oui, avec quel accompagnement : un membre du personnel, des proches ? Il s’agit là d’une question qui se pose très souvent dans les CHS.
Sur le formalisme de la sortie, la CAA indique : "il résulte de l'instruction que la fille de la patiente devait être consultée avant toute autorisation de sortie de sa mère et que cette instruction n'a pas été respectée".
Nous pouvons nous interroger sur la validation de cette sortie par les magistrats administratifs si la fille avait donné son autorisation ou si c’est elle qui avait accompagné sa mère dans le parc de l’hôpital (autorisation implicite ?).
Une traçabilité insuffisante
Pour répondre à l’argumentation du CHS, la CAA répond : "Il n'apporte aucune précision ni aucune pièce permettant d'apprécier la nature des mesures de surveillance mises en œuvre dans le cadre d'une telle sortie des bâtiments et leur adéquation avec l'état de santé de la patiente".
Dans cette affaire, comme dans tant d’autres, nous sommes confrontés à un problème de preuve, le CHS n’apportant aucun élément probant sur l’organisation des sorties des bâtiments. Les magistrats n’ont donc pas pu apprécier la qualité des mesures prises alors que cela aurait été capital dans ce dossier. Il est certain que cette absence de traçabilité a constitué un gros handicap dans la défense du CHS, sans pour autant affirmer que si les consignes de surveillance avaient pu être produites dans la procédure, elles auraient été considérées comme suffisantes.
Un défaut de surveillance
La CAA considère que : "Dans ces conditions, le CHS ne peut être regardé comme ayant pris des mesures suffisantes ou adaptées à l'état de santé de la patiente lui permettant de sortir du pavillon où elle était hospitalisée".
On pourrait y voir un renversement de la charge de la preuve, mais nous sommes dans le cadre de la responsabilité d’un centre hospitalier qui doit répondre de son organisation. La CAA en a finalement déduit "qu'un tel défaut de surveillance constitue une faute de nature à engager sa responsabilité".
La CAA estime donc que les sorties des unités fermées doivent être strictement encadrées, ce qui implique une organisation en amont et donc des protocoles à respecter. Elle déduit de l’absence de production de protocole par le CHS une faute de celui-ci et estime donc nécessairement qu’un protocole aurait évité cet accident et ses graves conséquences.
Cette position est bien réductrice car, en réalité, les protocoles ne sont pas toujours respectés ni efficaces à coup sûr...
Un préjudice bien particulier, mais indemnisé
Rappelons-le, c’est la SNCF qui a diligenté cette procédure et qui a dû décrire et prouver son préjudice, exclusivement financier.
Les magistrats ont retenu que : "la présence de la patiente sur la voie de chemin de fer située à proximité du CHS et l'accident qui s'en est suivi a nécessité l'intervention de personnels spécialisés pour la sécurisation du site, le contrôle et la vérification des infrastructures ferroviaires, l'immobilisation du matériel roulant et l'intervention d'un agent de conduite de relève. Cet accident a en outre nécessité le déploiement de modalités alternatives d'acheminement des voyageurs et induit des perturbations pour la circulation des autres trains".
La SNCF, régulièrement confrontée à des perturbations du trafic suite à des suicides, a voulu montrer l’importance des conséquences, tant sur les infrastructures que sur son personnel et ses clients.
Le chiffrage réalisé par la SNCF a abouti à un total d’un peu plus de 17 000 €, qui a été intégralement retenu par la CAA. C’est donc à cette somme qu’ont été condamnés le CHS et son assureur.
Une condamnation atypique
Voici une condamnation atypique d’un CHS à la réparation du préjudice d’un tiers par rapport à l’hospitalisation, donc en dehors de tout contrat de soins mais dans le cadre d’une responsabilité purement délictuelle. Il en a été de même dans les cas de mise en cause par des victimes d’agressions commises par les patients lors de fugues ou de sorties d’essai.
Cela nous rappelle le champs très large (et parfois imprévisible) de la responsabilité en psychiatrie, qui concerne non seulement les établissements, mais également les médecins psychiatres et les personnels chargés de la mise en œuvre de la surveillance permanente des patients.
Nous nous interrogeons enfin sur la possibilité pour la famille de la victime d’agir par la suite contre le CHS en réparation de son préjudice. Certes, le défaut de surveillance est acquis, mais il fait suite à une demande de sortie, sans concertation avec la fille de la victime, de la part de la mère et de la tante qui n’ont semble-t-il pas correctement surveillé leur proche…
Quelques leçons à tirer de cette décision
- Formaliser les règles de sortie de manière précise, en envisageant les différentes hypothèses de lieu (service, bâtiment, établissement), de condition (autorisation), d’horaires, d’accompagnement (personnel, stagiaire, proches…). Il s’agit là d’un équilibre difficile à trouver entre sécurité et respect des droits des patients. La position du contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) sur le sujet serait intéressante à consulter.
- Réévaluer régulièrement la situation des patients et adapter la surveillance en fonction des nouveaux éléments recueillis.
- Et surtout tracer la surveillance réalisée afin de pouvoir se défendre efficacement en cas de litige.